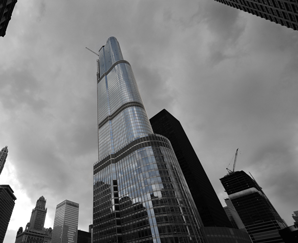
Cent jours de politique commerciale Trump : de noirs nuages s’amoncellent à l’horizon…
S’il est un domaine où la Présidence Trump était attendue, c’est bien celui de la politique commerciale, et des accords des États-Unis avec les pays tiers. Après un départ en fanfare, le Président a enchaîné une série d’initiatives largement symboliques, mais sans effet immédiat.
Par Jean-François Boittin
S’il est un domaine où la Présidence Trump était attendue, c’est bien celui de la politique commerciale, et des accords des États-Unis avec les pays tiers. Les paramètres de l’équation sont connus : un Président protectionniste dans l’âme, qui rejette l’orthodoxie économique (selon laquelle déficits ou surplus sont la différence arithmétique entre investissements et épargne d’un pays, et donc la résultante de la politique macroéconomique) pour y voir la conséquence des actions déloyales des pays tiers ; un entourage partagé entre « establishment » et réactionnaires militants anti-globalisation ; une dette envers les électeurs de la Rustbelt américaine, ces États du Midwest comme le Michigan, l’Ohio et la Pennsylvanie, qui ont permis son accession à la Présidence et sont indispensables pour une réélection en 2020. Trois raisons de craindre le pire. Mais après un départ en fanfare, avec le rejet du Partenariat Transpacifique (TPP), le Président a enchaîné une série d’initiatives largement symboliques, en signant des décrets demandant étude sur étude, mais de peu d’effet immédiat.
Le Président Trump a commencé par un feu d’artifice en rejetant le TPP, l’accord Transpacifique signé avec onze pays partenaires, fruit de huit ans de négociations, et qui visait deux objectifs : traduire dans le domaine économique et commercial le « virage vers l’Asie » de la diplomatie américaine, et définir les règles du jeu dans la zone avec l’ambition de les imposer, le moment venu, à la Chine. Le rejet en grande pompe, sous les flashes des photographes, était conforme aux engagements de campagne, mais restait purement symbolique : l’accord n’était pas entré en vigueur.
Dans les trois mois qui ont suivi, le Président a enchaîné avec la signature de décrets qui, pour l’essentiel, exigeaient des études sur les déficits bilatéraux des États-Unis et leurs causes, ou l’impact des accords sur les achats publics passés avec les pays tiers. Le document énonçant les objectifs de renégociation de l’ALENA suscitait des soupirs de soulagement de la communauté d’affaires, et des milieux agricoles, très inquiets de possibles rétorsions canadiennes ou mexicaines.
De même, la rencontre avec le Président chinois dans la « Maison Blanche floridienne », source initiale d’inquiétudes, se terminait dans la bonne humeur : les partenaires se donnaient cent jours pour étudier la situation et y trouver des remèdes. Quelques semaines plus tard, le Treasury américain évitait de désigner la Chine pour ses interventions sur les marchés des changes, ce qui aurait pu entraîner des rétorsions commerciales. Dans la foulée, le Président expliquait qu’il avait dû renoncer à la promesse, maintes fois répétée dans la campagne, de dénoncer la Chine pour sa « manipulation » du taux de change « dès le premier jour de son mandat » parce qu’il avait besoin de la Chine pour résoudre le problème de la Corée du Nord. Déclaration aussi paradoxale qu’imprudente : le candidat Trump n’avait de cesse de dénoncer l’attitude de son prédécesseur, accusé de sacrifier les intérêts des travailleurs américains à la diplomatie du pays, et la Chine a maintenant intérêt à garder la carte Corée du Nord en main le plus longtemps possible.
Cette ambiance de « drôle de guerre » commerciale a endormi l’attention des observateurs et analystes, réveillés brutalement la semaine dernière par les rumeurs d’une sortie imminente de l’ALENA, que le Président aurait ( ?) prévu d’annoncer lors du meeting de campagne tenu samedi en Pennsylvanie. L’abandon de l’initiative, « pour l’instant », a ramené le calme. Il ne doit pas faire illusion ni cacher les trois dangers qui menacent aujourd’hui les acteurs économiques étrangers, et les partenaires commerciaux des États-Unis : une recrudescence des plaintes antidumping et anti-subventions, la fermeture des frontières au nom de la sécurité nationale américaine, et une possible sortie de l’OMC.
Outil traditionnel du protectionnisme américain, les plaintes antidumping et anti-subventions se voient promettre un avenir radieux. Le Secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, protectionniste assumé, a promis, et déjà mis en œuvre, un activisme renforcé : ses équipes ont récemment procédé à un nouveau calcul, à la louche, de marges de dumping sur un acier coréen, qui a conclu à des droits de plus de 20 %, et les mêmes « experts » ont conclu à des subventions d’un même montant sur du bois d’œuvre importé du Canada. Il n’y a guère de doute que, dans ce contexte, les entreprises américaines vont faire la queue devant les guichets antidumping, assurées d’avoir trouvé la martingale. Boeing vient de déposer une plainte contre son concurrent canadien Bombardier, et une entreprise de panneaux solaires en faillite, Suniva, vient, contre l’avis de l’association professionnelle du secteur, de demander une mesure de sauvegarde. Du moins les procédures en la matière sont, partiellement, contrôlées par l’intervention d’un organisme chargé de constater la réalité du préjudice subi, et peuvent faire l’objet de contentieux à l’OMC.
Plus dangereux, à l’inverse, sont les recours à une disposition législative qui n’a été que rarement utilisée depuis son vote en 1962 : la section 232 du Trade Act, qui permet au Président, après une enquête du Département du Commerce, de prendre les dispositions nécessaires pour limiter les importations qui menaceraient la sécurité nationale des États-Unis. Deux enquêtes ont été lancées fin avril, dans les secteurs de l’acier et de l’aluminium, et d’autres pourraient l’être (semi-conducteurs, construction navale). Quels sont les dangers liés à cette procédure ?
Tout d’abord, l’absence de contrôle du Congrès, qui est simplement consulté, mais ne doit pas approuver formellement la mesure. Ensuite, la subjectivité du concept de sécurité nationale : pour mémoire, un certain nombre d’élus voulaient interdire au nom de la sécurité nationale le rachat de la société Smithfield, gros producteur de porc, par une entreprise chinoise, par crainte sans doute que le moral des GIs ne souffre en cas de manque du « bacon » quotidien. Mais aussi la partialité du Département du Commerce, « structurellement » protectionniste. La difficulté des recours devant la justice : les cours américaines sont traditionnellement réticentes à censurer le gouvernement lorsqu’il invoque le besoin de protéger le pays. Enfin, l’absence de protection offerte par l’OMC : l’article XXI du GATT donne un « joker » au membre qui invoque l’exception de sécurité, et aucun recours pour abus de pouvoir n’a abouti.
Les pays tiers concernés par des restrictions ne sont pas totalement désarmés : l’OMC prévoit la possibilité de reconstruire un équilibre des concessions en cas de remise en cause, pour quelque raison que ce soit, des conditions d’accès à un marché tiers. Si elle était affectée par une section 232, l’Union Européenne pourrait pénaliser les exportations américaines à hauteur du dommage subi, et devrait annoncer dès maintenant son intention de le faire.
Le dernier danger que suggère l’étude sur l’impact des accords passés par les États-Unis sur leurs déficits est la tentation d’une sortie, ou menace de sortie de l’OMC. Wilbur Ross a profité de l’annonce du lancement de cette étude pour dénoncer l’organisation comme « l’archétype des accords commerciaux » (« the mother of all trade agreements » dans le texte), et par là même responsable de la plupart des déficits américains. Cette hostilité s’explique par l’opposition de l’administration à deux principes fondateurs du GATT repris par l’OMC :
- la clause de la nation la plus favorisée, qui oblige à imposer le même droit de douane à tous les pays membres de l’OMC (à l’exception évidemment des pays parties à un accord de libre-échange). Or le Président bat les estrades en parlant de droits « réciproques » qui seraient imposés aux pays tiers en fonction de leurs surplus à l’égard des États-Unis ;
- la clause de traitement national, qui interdit les discriminations du type de celle que le Président exigeait pour la construction des oléoducs Keystone et Dakota Access : utilisation d’acier « made in the USA ».
Mais le respect des règles de l’OMC mettrait aussi les États-Unis en position de faiblesse en cas de dénonciation de l’ALENA ou de l’accord passé avec la Corée : ils se verraient appliquer par ces partenaires les droits « enregistrés » par devant le « notaire » OMC, beaucoup plus élevés en moyenne que les droits américains correspondants. Le seul moyen pour les États-Unis d’établir un rapport de forces favorable serait donc de sortir de l’OMC, ce dont rêvent les éminences noires, ou brunes, de la Maison Blanche, les Bannon et Navarro.
Là aussi, l’Union Européenne a le devoir d’anticiper : pourquoi ne pas prévoir dès maintenant une clause fixant à un niveau prohibitif de 50 % les droits qui s’appliqueraient à tout pays qui voudrait se soustraire aux règles de l’ordre économique international en quittant l’organisation ?
|
Retrouvez plus d'information sur le blog du CEPII. © CEPII, Reproduction strictement interdite. Le blog du CEPII, ISSN: 2270-2571 |
|||
|

